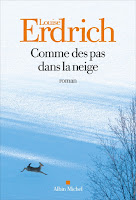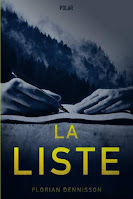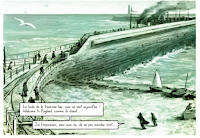L’automne est la dernière saison (Payiz fasl-e akhar-e sal
ast)
Auteur : Nasim Marashi
Traduit du persan (Iran) par Christophe Balaÿ
Éditions : Zulma (12 Janvier 2023)
ISBN : 979-1038701564
272 pages
Quatrième de couverture
Dans le brouhaha des rues agitées de Téhéran, Leyla, Shabaneh et Roja sont à l’heure des choix.
Trois jeunes femmes diplômées, tiraillées entre les traditions, leur modernité
et leurs désirs. Leyla rêve de journalisme ou de devenir libraire. Son mari,
pourtant aimant et attentionné, a émigré sans elle. A-t-elle eu raison de ne
pas le suivre et de rester ? Shabaneh est courtisée
par son collègue, qui voit en elle une épouse parfaite. Comment démêler si elle
l’aime, si elle peut se résoudre à abandonner son frère handicapé, alors
qu’elle en est l’unique protection ? Roja, la plus ambitieuse, travaille dans
un cabinet d’architectes, et s’est inscrite en doctorat à Toulouse – il ne
manque plus que son visa, passeport pour la liberté. Vraiment ? La solution
est-elle toujours de partir ?
Mon avis
Nous sommes en Iran, à Téhéran, de nos jours et Leyla,
Shabaneh et Roja arrivent à un moment clé de leur vie.
Leyla est mariée, son époux lui propose de partir au Canada
où il pourra continuer ses études. Elle, elle vient juste de trouver un job et
elle hésite. Il part, elle reste et elle veut comprendre cette absence. Elle n’arrive
pas à continuer la route, à avancer…
Shabaneh est hantée par la guerre. Elle s’occupe énormément
de son petit frère, qui est en situation de handicap. Elle ne se sent pas
capable de partir et de le laisser derrière elle car elle sait bien que leur
mère n’assumera pas. Pourtant, elle a le droit de penser à elle ….
Roja rêve de partir pour son doctorat à Toulouse. Elle
attend avec impatience son visa.
Toutes pensent à une autre vie, un quotidien différent avec
un peu plus de libertés. C’est un récit choral, chaque chapitre donne la parole
à l’une d’elles et l’histoire s’étend sur deux saisons : l’été et l’automne.
L’auteur ne parle pas de politique mais on sent que rien n’est simple pour les
femmes. Déjà elles sont tiraillées entre ce qu’on leur a inculqué et ce qu’elles
souhaitent, ensuite, certaines ne s’autorisent pas à vivre avec une certaine
forme de liberté comme si elles culpabilisaient par rapport à leur mère, leur
grand-mère, qui n’ont pas eu cette possibilité.
Comment « grandir », avancer, vivre au grand jour
tout simplement ?
Ce roman est très poétique, l’écriture (merci au traducteur)
est délicieuse. Les informations sont données par petites touches. On pénètre
sur la pointe des pieds dans ce pays où rien n’est vraiment facile. On découvre
des portraits de femmes avec leurs hauts et leur bas, parfois battantes,
parfois un peu désabusées mais ce qui est le plus important, le cœur de tout
ça, c’est leur amitié.
Elles sont là, les unes pour les autres, présentes, à l’écoute,
respectueuses, aimantes. Leur lien est fort, solide et passe par-dessus les
tempêtes.
J’ai lu que Nasim Marashi écrit lentement, parfois un seul
paragraphe par jour. Elle permet à ses personnages, au paysage, au contexte, de
s’installer en elle avant de les décrire. En lisant cela, j’ai eu le sentiment
qu’elle voulait leur donner le temps de prendre vie avant de leur donner la
parole et de les laisser seuls-es, sur le papier….
Une très jolie découverte.